Je reviens, sept mois après ce dernier article.
Enfin, la méduse revient... avec ses petits filaments tout poisseux 
Voilà, j'ai disparu tout ce temps, parce qu'un petit phénomène – matériel météorologique et événementiel – a mangé tout mon temps, ou presque. C'est marrant, parce que le dernier article posté ici l'a été le 27 juin 2011, et c'est le hasard, en fait - mais c'est très exactement ce jour-là que le phénomène a débarqué, à 16h59.
J'ai décidé de faire une chose que je ne fais pas d'habitude sur la méduse : raconter ma vie.
Je n'ai pas ouvert la méduse pour ça, et je ne le ferai plus ensuite.
Seulement, là, une fois, après ce trou de sept mois qui est déjà une anormalité sur le mollusque, j'ai comme envie de déballer, dans ce grand article qui promet d'être sacrément désordonné, déballer les choses – petites grandes tordues douloureuses fraîches ou intestines – toutes ces choses, ces pensées, ces épreuves, qui me sont venues.
Pour en quelque sorte rendre raison de ce trou de sept mois.
Et aussi parce que bon, comme a dit un jour une bloggeuse de mes amies – ton blog, c'est chez toi hein, tu peux y coller ce que tu veux... Alors raconter sa vie ma foi, pourquoi pas, si ça nous chante. Et alors.
Non seulement je vais raconter ma vie, mais en plus, je vais le faire n'importe comment, voilà – en gros blocs de textes pas articulés, en fleuve, en logorrhée, en chantier, en pas fini, en qui mène nulle part. Tant pis.
* * * * * * *
Je n'ai pas lu de littérature sur ce thème (faire / avoir un enfant, être parente), il doit assurément y en avoir un bon monticule – et des choses à méditer. Si - j'ai tout de même lu la Femme gelée d'Annie Ernaux – ça mériterait un petit article, tiens, en plus de celui-là – le faire-des-enfants dans la vie d'Ernaux (ou de sa narratrice)... 
J'ai aimé lire cet article récent de Mona Chollet sur le film « 17 filles » :
[ « On reste néanmoins perplexe : subversive, la maternité ? Si 17 filles peut défendre cette thèse, c’est que, en tant que film français de bon goût, il évacue résolument toute la culture populaire dont notre monde est baigné ; c’est-à-dire la culture où apparaît de façon flagrante la survalorisation de la maternité, pour ne pas dire sa valorisation exclusive, qui reste aujourd’hui dominante dans de larges pans de la société. » […] « lorsque tout votre environnement culturel vous martèle que le rôle de mère est « le plus beau » qu’une femme puisse endosser - non pas un beau rôle parmi d’autres, mais le plus beau -, il y a une certaine logique à vouloir zapper les autres étapes. Autant accéder tout de suite à ce statut censé vous apporter toute la considération que vous pouvez espérer et mettre un peu de sel et d’action dans votre existence, en vous dispensant de les chercher ailleurs - ou aussi ailleurs. »]
Dans le film Les témoins d'André Téchiné, Emmanuelle Béart interprète une femme qui laisse pleurer son bébé pendant des heures en se mettant des boules Quiès pour pouvoir travailler, et qui dit ensuite au père de l'enfant qu'elle ne doit pas être faite pour être mère, qu'elle ne pouvait pas le savoir avant de le devenir, mais que se transformer en baleine pendant neuf mois puis ne plus dormir de la nuit pendant les mois qui suivent c'est vraiment pas son truc – j'ai beaucoup aimé cette facette du personnage qu'elle incarne, d'une part parce que l'on voit rarement de telles scènes au cinéma, d'autre part parce que ce qui pourrait être taxé de comportement de « mauvaise mère » n'est pas au centre du récit, n'est pas réellement traité comme un problème, ça se passe comme ça, et puis c'est tout, puis c'est pas si grave, puis le bébé n'en meurt pas, ni n'en devient psychopathe ou autiste – juste Béart rame et gueule - voilà.
J'aime beaucoup cet article de Clémentine Autain sur son blog – pas révolutionnaire, mais carré, clair, et juste, je trouve.
Puis cet article (qui n'est plus en libre accès...) de Virginie Descoutures sur SciencesHumaines.com, super intéressant, sur « le quotidien des mères lesbiennes » : où l'on apprend que la figure du père, et la référence à la « vraie » famille, reste très prégnante (« un papa c'est important », il faut savoir « d'où l'on vient »), que les mères non biologiques, « moins femmes que les vraies femmes parce qu’homosexuelles, moins mères que les vraies mères parce que sans lien biologique avec leur enfant et sans statut juridique pour pallier cette carence, [...] risquent de voir leurs compétences parentales sans cesse remises en cause », et que les tâches domestiques sont le plus souvent inégalement réparties entre les deux mères. L'auteure conclut qu'« une action sur les normes s’opère [...] du seul fait que l’existence de ces familles introduit dans les relations qu’elles engagent au quotidien avec le reste de la société une redéfinition des possibles. »
* * *
Je sais qu'une grossesse peut être physiquement vécue comme un effroyable empèsement - comme si on t'engluait dans quatre tonnes de goudron-béton, qui t'écrasent et te figent ; tout devient lourd, lent, pénible, fatigant. Moi perso j'avais plutôt l'impression de couver une bulle d'air, vaguement volumineuse, un peu fragile.
J'ai pu expérimenter les mille signes de la valorisation sociale de la grossesse et de la maternité. Ébahie et dérangée par ce mot (passe-partout) qu'on m'a répété pendant des mois : félicitations. Mais félicitations pour quoi ? (« Et les autres... je ne vous dis pas bravo ! »  )
)
Je sais qu'un accouchement peut être une grosse épreuve de trash et de sang ; je trouve ce récit d'Agnès Maillard effrayant et précieux - il dit toute l'infinie violence que peut constituer un accouchement médicalisé.
(extraits)
"Mon corps ne m'appartient plus, il est une extension anonyme du grand corps médical tout puissant. […]
La salle de travail est purement fonctionnelle et pensée pour faciliter le travail du plateau technique. Nous y sommes des intrus. C'est un hall de gare dont les portes battantes laissent parfois passer une petite foule en blouse de couleur qui vient s'informer sans aucune forme de civilité de l'état de ma dilatation et qui commente cette violation de ma chair intime avec la même indifférence que si j'étais un objet. […]
Mon corps entier vibre d'indignation contre le traitement qui lui est infligé. […]
Je suis en train de m'éloigner de toute cette souffrance et je ne me rends même plus compte que c'est moi qui suis en train de hurler comme une bête blessée. […]
J'ai seulement peur. Par flash confus, je me rends compte que je vais mourir. Je pousse, je pousse, à m'en déchirer les entrailles, mais il n'y a plus rien, plus de jus. Je crois bien que la sage-femme m'engueule. Puis, après un temps flou et indéterminé, je vois les bottes blanches de l'obstétricien emplir mon champ de vision. Ce sont les mêmes que celles que chaussent les ouvriers dans les abattoirs à canards. On a glissé un seau à la verticale de mes fesses pour y recueillir tous les fluides qui s'écoulent abondamment de moi. L'homme est en train de monter bruyamment une sorte de gros couvert à salade. Qu'il enfonce sans préavis dans mon sexe pour y chercher la tête de ma fille. J'ai l'impression d'être écartelée. Quelqu'un pose une petite chose vagissante sur ma poitrine lourde et tendue comme un tambour, mais mes bras sont tellement faibles que je n'arrive pas à la tenir. Je cherche du regard quelqu'un pour m'aider, mais déjà, tout le monde s'affaire sur autre chose. C'est finalement son père, pâle, ravagé, en état de choc, qui aura la présence d'esprit de me tenir le coude pour que je ne laisse pas échapper mon enfant par terre, du haut de mon étroit lit de souffrance. Je devrais être heureuse. J'ai juste froid et envie de pleurer. Voilà tout ce qui reste de ce qui aurait pourtant dû être le beau jour de notre vie."
De mon côté les médecins/doctoresses et tout le corps médical, je les ai vus et revus - j'ai dormi avec (quoi que pas dans le même lit)... Moi qui ne suis pas pote avec eux, pourtant : je ne l'ai pas mal vécu. Pourquoi ?
J'ai détesté les médecins pendant des années parce qu'ils me disaient mon anormalité, ils me jugeaient avec leurs airs condescendants, j'en avais peur, et en même je les haïssais, ils me dominaient - j'étais la petite chose révoltée dépenaillée et ridicule, avec qui ils avaient envie d'être gentils parfois (et d'autres fois ils s'en foutaient) ; j'étais l'échec répété, j'étais le cas pas grave mais atypique, la déformée. Plus tard j'allais les voir pour ma gorge ou mon mal de bide, et j'avais les mains moites dans la salle d'attente - qu'allaient-ils penser de ma maladie toute petite, ils allaient se foutre de moi, je n'aurais jamais dû venir, je n'avais pas assez mal c'est certain - le souci de mon bien-être était ridicule. ILLEGITIME.
Là (terrible de reconnaître et d'écrire ça) : j'avais RAISON d'être là, c'était BIEN : j'étais ENCEINTE. J'avais tous les droits d'aller voir les médecins, et en plus, ce n'était même pas pour moi. Fantastique cette légitimité d'être-au-monde qui te vient quand ce n'est plus pour toi, mais - comble du bon droit - pour un BEBE. Un ENFANT. (Protéger. Prendre soin. Prendre tous les soins. Les précautions.) (Tu deviens quelqu'un de bien en croûtant toute la journée dans un canapé - mais sans manger de chips, quand même.)
L'accouchement. Est-une expérience unique, magique ? pfff... non, c'est une expérience qui peut être vécue de douzaines de façons différentes... (comme tout ? certainement...) C'est un truc étrange comme un truc qu'on fait pour la première fois - comme d'aller pour la première fois dans un restaurant à nouilles (ça c'est pour le côté social du truc : les codes, les gens, les lieux, le mode d'emploi), ou comme la première fois de ta vie que tu vomis (pour le côté physiologique et sensuel - c'est vrai, la toute première fois, tu trouves ça étrange, non, comme expérience, vomir ??) Le côté "magique" provient exclusivement de la saturation de significations sociales et culturelles de ce fait – accoucher /faire-voir naître. [Des fois je me demande quelle est la différence entre "social" et "culturel", genre dans cette phrase, là.... Bon, tant pis.]
Bien sûr il y a des récits de ce fait/cette expérience dépouillés de toute magie (heureusement ils existent) : on l'on raconte qu'un truc vaguement dégueu, un petit tas de chair, rouge, sort de soi comme un étron.
Donc. Le sang les cris le trash, ou bien : cet être brun un peu mouillé qui sort de moi comme un petit suppositoire bien huilé, sans faire de bruit, doucement, presque (calmement) - après qu'on se soit bien bidonné avec la sage-femme et ses copines, parce que j'avais manqué de me péter la gueule de mon lit dans le bassin.
Bref. Pas d'expérience unificatrice vécue par la troupe de toutes ces femmes-qui-ont-accouché.
(J'écris quoi là au fait, avec mes histoires de diversité-de-l'expérience-vécue ?... Ah oui. L'idée, c'est ce truc du corps-vécu-mâle qui serait essentiellement différent du corps-vécu-femelle. Bon, j'y crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait cette barrière, là, essentielle, radicale, objective, en soi... (je rajoute des adjectifs ou c'est bon ?) Et même pas entre les mâles et les femelles-ayant-accouché : pas d'expérience ultime de l'enfantement, irréductible, blablabla... Façon genrée d'habiter son corps, oui (bien sûr), dressage des corps. Donnée irréductible de la matière ? Je dirais que sans doute, davantage que le caractère sexué du corps, ce qui peut dresser non pas une barrière, une frontière, entre deux types de corps-vécus, mais ordonner une sorte de palette, un kaléidoscope, un herbier, .... ce serait d'une part la corpulence, d'autre part la maladie. (Bon, c'est mon opinion à moi que j'ai. D'autres propositions ?))
* * *
Évidemment élever cet enfant de façon féministe représente maintenant l'un des buts de ma vie........ Élever un enfant de façon féministe ; élever une fille de façon féministe. Ça creuse des tunnels dans ma tête.
Pour une part, c'est facile : les jouets, les vêtements, les discours explicites qu'on lui tient - fastoche. Restent deux grands océans : le monde (tout ce qui nous échappe, toutes ces petites mains connues et inconnues qui vont modeler sa tête de piaf), et puis, tout ce qui nous échappe à nous, dans notre propre comportement, dans nos paroles, dans ce qu'on est, dans notre organisation plus ou moins contrainte, dans les choix que l'on fait à moitié, dans toutes nos erreurs..... dans notre corps et notre cerveau dressés-genrés, parce que je suis bien un petit château de sable genré, parce que je suis imbibée, parce que j'essaie de m'essorer mais c'est pas simple....
Ne pas filliser ce bébé, zapper l'étape de l'étiquetage - que ça reste le plus longtemps possible un bébé neutron - on a quelques techniques pour développer ça : éviter le rose, les robes, les trucs dans les cheveux. Je fais gaffe à ce que je lui dis : qu'elle a des biscottos, qu'elle est costaud, courageuse. Je l'affuble de petits surnoms féminins et masculins.
J'appréhende la période princesse - pour moi, ça sera Finemouche sinon rien. Faire exister dans son petit monde autant de couples hétéro que de couples homos - que ça soit aussi réel, concret, vivace, dans son petit univers d'images et de représentations, même si ça ne tiendra pas longtemps devant l'effroyable vague d'hétéronormativité du grand monde extérieur... (Je pourrai recustomiser tous ses bouquins : écrire dans les marges et coller des bouts de photos et de dessins de partout pour déshétéronormer toutes les histoires.... Ou voter la parité : pour tout bouquin hétéro qui entre dans la maison, un bouquin homo. Et paf. Je sais, on va ramer... ben sinon on les écrit nous-mêmes....) Puis faudrait pas seulement des couples homos : aussi des personnes heureuses & épanouies sans être en couple ; des personnes qui vivent seules leurs vies et qui prennent leur panard, des personnes qui habitent ensemble parce qu'elles sont ami.e.s, des personnes qui habitent à trois (ben ouais), qui habitent en communautés, qui... enfin, d'autres modèles que petitoursbrunetsonpapaetsamaman, D'AUTRES MODELES.
* * *
Je n'emploie pas le terme "mère", quand je parle de moi (encore moins le mot "maman" quand on parle entre adultes : "je suis la maman d'une petite fille de..." - beurk) - je préfère être "parente". Un rôle de parente, ne pas être une parente trop nulle... Je vise l'indifférenciation maximale de notre présence auprès de cet enfant - à moi et à l'autre parent. (Pour ne pas dire "rôle". "Fonction".)
Différenciation des tâches :
la mère est davantage présente,
la mère en fait plus,
la mère s'occupe davantage des plus petits, le père des plus grands,la mère est plus douce (câline),
la mère rassure davantage quand l'enfant pleure / quand l'enfant pleure il réclame d'abord sa mère.
Je ne veux pas être fusionnelle avec cette enfant ; je ne veux pas que l'autre parent serve de "tiers séparateur" (me reviennent à l'esprit les frissons (de rage et d'horreur) qui m'avaient parcouru à la lecture de Badinter) ; je ne veux pas en faire plus ; je ne veux pas de cette asymétrie entre lui et moi qui fera que l'enfant me réclamera plus. Comment faire pour ne pas être cette "maman" ? (Où ranger toute notre socialisation genrée, qui façonne mon rapport aux enfants en général (et à celle-ci en particulier), et son rapport aux enfants et à cette enfant ?)
Les dés sont pipés dès le début - pas à cause de la grossesse (la belle affaire), pas à cause de la "nature", à cause du congé maternité - très social et institutionnel, celui-là. Sauf circonstances particulières (chômage, choix de non travail, travail à dom', VLV (very longues vacances).... tout ça), après ses petits 11 jours de congé paternité auquel il a droit s'il a pénis, et autres petites vacances si il/elle a de la chance, l'autre parent reprend le chemin de ses journées-à-plein-temps, et parent-qui-a-accouché se retrouve avec le petit machin du matin jusqu'au soir, dans un joli tête-à-tête, parfois poétique, parfois angoissant, étrange en tout cas - souvent addictif : je dis pas que la relation en soit particulièrement altérée, prenne un tour particulier (maternisant) du côté du petit être (j'en sais rien du tout, et en tout cas, je n'en ai rien vu : le machin que je couvais (de l'œil et du bras) ne manifestait aucun signe de reconnaissance - il se comportait de la même façon dans mes bras, dans les bras de l'autre parent, et dans les bras d'un/une qu'il n'avait jamais vu.e de sa courte vie ; ce qu'il voulait, c'était des bras - après, les bras de qui, il semblait s'en carrer comme de sa première chaussette.) Pas du côté du petit, donc, mais de mon côté, assurément : ma relation à lui prenait un tour bien particulier : un tour de poule, un tour qui me construisait (un peu) comme une mère, un tour qui me particularisait, qui fabriquait un peu de cette asymétrie entre moi et le papa. Qui a fait que quand, au bout de deux mois, je l'ai laissée à l'autre parent pendant deux heures trente pour prendre le métro (ô le monde extérieur !) pour aller dans des magasins (ô le monde extérieur !) (je sais, ça aurait été vachement plus classe d'aller au Louvre pour mes deux premières heures trente de liberté  ) - je me suis trouvée dans un état de névrose aggravée - est-ce que ça va, est-ce que ça va, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que ça va, est-ce que... je me sentais vide et ballante comme un manchot qui a perdu son œuf, toute stressée - je me suis dit : "en quoi suis-je en train de me transformer ???!!" En ça. En parente genrée frappée d'asymétrie. Paf. La honte.
) - je me suis trouvée dans un état de névrose aggravée - est-ce que ça va, est-ce que ça va, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que ça va, est-ce que... je me sentais vide et ballante comme un manchot qui a perdu son œuf, toute stressée - je me suis dit : "en quoi suis-je en train de me transformer ???!!" En ça. En parente genrée frappée d'asymétrie. Paf. La honte.
Je vise l'indifférenciation maximale des tâches / rôles...
[ Cet article de Virginie Descoutures traite, donc, du partage du travail de soin aux enfants dans les couples de femmes. L'enquête qu'a menée la chercheuse montre que ce partage est rarement égalitaire : "on ne retrouve certes pas de couples où l’une "jouerait la femme" (en n’accomplissant que des tâches féminines) et l’autre "jouerait l’homme" (en se réservant le bricolage et le jardinage). Mais les femmes qui en font davantage sont généralement celles des deux membres du couple qui ont un revenu inférieur à celui de leur compagne et dont l’absence à l’extérieur du logement (sur le lieu de travail) est plus courte, du fait d’un temps partiel de travail." V. Descoutures note tout de même que les inégalités au sein des couples lesbiens sont globalement moins fortes que dans les couples hétérosexuels. L’explication vient peut-être, écrit-elle, du fait qu'elles sont "toutes deux soumises à l’obligation (renforcée par la suspicion liée à leur homosexualité) d’être une « bonne mère. »" ]
* * *
Ma socialisation comme fille / femme a fortement marqué la façon dont je gère mes émotions - dont je ne les gère pas, en fait, principalement  . On pourrait dire que je suis très "émotive". Que ça monte vite, me submerge, que j'en mets partout. Là encore, mon indifférenciation des rôles en a pris un coup... faudrait d'abord voir à ne pas se construire en femme / homme pour ne pas se comporter en mère / père.... (ce qu'on peut, ce qu'on peut, faire ce qu'on peut....)
. On pourrait dire que je suis très "émotive". Que ça monte vite, me submerge, que j'en mets partout. Là encore, mon indifférenciation des rôles en a pris un coup... faudrait d'abord voir à ne pas se construire en femme / homme pour ne pas se comporter en mère / père.... (ce qu'on peut, ce qu'on peut, faire ce qu'on peut....)
Ne pas construire ma fille comme fille.
(Vais-je me retrouver avec l'assistance sociale aux fesses ?)
"Toute différenciation est une hiérarchisation, tout acte de socialisation féminine est une amputation." (C'est une citation de personne, hein, juste un essai de voix - écouter comment cette phrase sonne, s'interroger.)
* * *
Quand j'étais enceinte, j'ai fait attention à ne pas utiliser le prénom du futur enfant pour parler du fœtus - parce que les fœtus ne sont pas des personnes, parce que sinon la pente est glissante.
(J'avais du mal, cependant, à neutraliser ce penchant en moi : le goût de la relation avec un être imaginaire. Parce que j'ai longtemps été animiste, j'ai passé de longues années à converser dans ma tête avec les petites cuillères, les chaussures et les oreillers qui m'entouraient. De là à tenir salon avec un petit paquet de gras dans son ventre, il n'y a qu'un pas.)
* * *
Il est évidemment important que toutes les femmes puissent faire le choix de ne pas avoir d'enfants : Clémentine Autain a super raison d'insister, dans un article sur la maternité, sur l'accès à la contraception et à l'avortement, sur l'urgence qu'il y a à se battre pour que les centres d'IVG restent ouverts et que les médecins continuent, plus nombreux, à pratiquer cet acte (on pourrait aussi parler des conditions d'accès à l'avortement et des conditions dans lesquelles cet acte est pratiqué).
Mais je pense qu'au-delà de cette affirmation, « toutes les femmes doivent pouvoir de pas avoir d'enfants », il faut s'interroger sur les conditions politiques du fait de ne pas avoir d'enfants (ou d'en avoir) ; sans doute beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais je continue à penser, de façon bornée et totalement schizophrénique, qu'il est davantage féministe, dans notre société, d'exister comme femme sans enfant plutôt que comme femme avec enfant(s).
* * *
Je crois pouvoir écrire que j'ai vécu mes premiers mois avec cette enfant comme une épreuve sportive. Une épreuve d'endurance, qui mettrait au défi mes nerfs, ma patience, ma capacité de résistance à la fatigue physique et mentale.
Le plus changement le plus frappant dans ma vie, depuis l'arrivée de ce petit être, c'est l'engloutissement de mon temps. Un festin de temps au ralenti - le temps passé avec un bébé est un temps étrange : on ne fait (presque) rien, et ce rien remplit tout.
Tous les bébés ne se comportent pas de la même façon - et les adultes avec eux non plus (y aurait-il un lien entre les deux ?), et je sais bien que certains adultes parviennent à faire tout un tas de trucs en gardant un bébé (je le sais et ça m'émerveille) (si comme la narratrice de la Femme gelée j'avais dû préparer mon Capes de Lettres en gardant le koala, je pense que j'aurais bien fait marrer le jury). La mienne la nôtre [n'appartient à personne] est du genre petite sangsue à temps plein : pendant des semaines et des mois elle est restée perchée dans nos bras, comme le baron de Calvino dans son arbre, et de nos bras, du coup, on ne pouvait pas faire grand chose - toute la journée. Aujourd'hui elle consent à en descendre un peu si l'on ne s'éloigne pas plus d'un mètre pendant moins de quatre minutes (sieste y compris) (j'exagère à peine) - forcément, notre temps en est tout bouleversé.
En fervente adepte du constructivisme radical, je considère que rien dans son comportement ne lui vient de son gène numéro 4 ou de la position des étoiles dans le ciel - que tout lui vient de ce petit jeu de légos qui a commencé avec elle, et où ce qu'elle est se construit, progressivement, au rythme de ses interactions avec le monde, avec nous, avec moi aussi, au rythme de ses interprétations de toute cette bouillie... Alors si elle ne descend pas de nos bras (par exemple), c'est... c'est pourquoi ? Je ne maîtrise pas les règles de ce jeu - je n'ai aucune idée des conséquences de ce que je fais et ce que je ne fais pas, et de comment je le fais - c'est beaucoup trop compliqué... (savoir ce qu'il faut faire.... bien faire... (gouffre d'incertitudes...))
Quand elle est née, je me suis sentie dépassée par sa perfection : ce bébé était trop beau, trop parfait, c'était trop grand, trop ; parce que, sans doute, j'avais imaginé ce bébé prématuré et malade, ou trisomique.
A plusieurs reprises, durant les premiers mois, mes petits nerfs fragiles chargés à plein temps de me donner la figure d'une fille normale et enjouée ont craqué (comme la glace qui craque sous les pieds du pingouin), et je me suis vue, transformée en une flaque, qu'a dû éponger l'autre parent. (Un peu de honte, un peu de peur, beaucoup de honte, quelques hoquets, de la fatigue). Une incapacité à penser tout ça féministement. Le ressenti de ma honte et de ma culpabilité dépassaient largement les discours politiques féministes que j'aurais pu tenir à n'importe quelle femme à ma place et dans mon état d'éponge.
* * *
« La maternité est devenue l’expérience féminine incontournable, valorisée entre toutes : donner la vie, c’est fantastique. La propagande “pro-maternité” a rarement été aussi tapageuse. Foutage de gueule, méthode contemporaine et systématique de la double contrainte : “Faites des enfants c’est fantastique, vous vous sentirez plus femmes et accomplies que jamais”, mais faites-les dans une société en dégringolade, où le travail salarié est une condition de survie sociale, mais n’est garanti pour personne, et surtout pas pour les femmes. Enfantez dans des villes où le logement est précaire, où l’école démissionne, où les enfants sont soumis aux agressions mentales les plus vicieuses, via la pub, la télé, Internet, les marchands de soda et confrères. Sans enfant, pas de bonheur féminin, mais élever des gamins dans des conditions décentes sera quasiment impossible. Il faut, de toutes façons, que les femmes se sentent en échec. »
Virginie Despentes, King Kong Théorie
Ce n'est pas la même chose d'élever un enfant avec ou sans fric. Les conditions dans lesquelles on a un enfant en changent complètement la réalité – conditions de temps, de dépendance, de pauvreté.
(Sans enfant on a davantage de temps et d'argent ; avec, on a plus de reconnaissance et de gratifications sociales – AH : on a plus d'amour aussi  .
.
Ça veut dire quoi, aimer un bébé ? C'est un truc étrange.)
* * *
Ce qui est le plus dur, pour moi, sans aucune hésitation : ses pleurs, ses cris, parfois ses hurlements. A tel point que la question « vais-je y arriver avec ce bébé ? » s'est vite traduite en « vais-je réussir à affronter ses crises de pleurs ? » Une épreuve terrible pour moi.
Éprouver son impuissance face à ce qu'on lit comme une immense détresse, une terreur. [ Je deviens aussi angoissée qu'elle, tendue comme une punaise, à vif, ses hurlements me plongent dans un état de nerf et finalement un désespoir profond. ]
Finalement je me dis qu'on pourrait proposer comme test ultime de personnalité aux gens qui partent dans l'espace ou dans un sous-marin et dont les nerfs doivent être d'acier d'affronter les trois heures trente que peut durer une crise de ce bébé.
C'est tellement fragile, un bébé, on peut le tuer fastoche, en quelques secondes. Avant qu'elle naisse, j'avais des flash, souvent : je la lâchais, elle tombait, elle passait par la fenêtre, se fracassait contre une table. C'est fou d'avoir la responsabilité d'une vie.
* * *
Pour essayer d'écrire un truc vaguement organisé (attendez les gars je chausse mes lunettes), je dirais que le fait d'avoir un enfant met en question et transforme notre rapport à trois éléments : dans cette expérience sont en jeu notre rapport au temps, au pouvoir, et aux normes.
Au temps, parce qu'un enfant aspire et fait des corn flakes de notre temps libre. [ Petite parenthèse : quand je parle de temps libre, ici, je parle en tant que moi et de ma classe... Parce que l'expérience que peut avoir du temps libre une femme certes sans enfant, mais employée dans une société de ménage (par exemple), qui a quatre tranches de ménage à faire dans la journée dans quatre lieux différents de la région parisienne, et qui rentre chez elle pour croûter sur son lit et essayer de vaguement reconstruire ses forces pour la journée d'après... est certainement fort différente de la mienne. ]
Aux normes, parce qu'avoir un/des enfants est un enjeu puissant de conformation sociale, en particulier pour les femmes.
Au pouvoir enfin parce que je trouve cet appel à contribution passé sur la liste Efigies pas con du tout – qui dit :
« Aujourd'hui, dans le monde entier, les humains vivent leurs premières dix-huit années sous un statut social particulier : le statut de mineur régit dans tous ses aspects la vie de 20 à 50% de l'humanité. Ce "minorat" est justifié par l'idée de nature : le caractère inabouti du développement corporel et mental des moins de dix-huit ans, leur manque constitutif de discernement censé en découler, nécessite de leur imposer un statut dérogatoire au droit commun (Delphy). Ils sont ainsi placés automatiquement sous tutelle soit de leurs géniteurs, soit d'adoptants, soit de "professionnels de l'enfance", salariés d'institutions spécialement dédiées à leur cas spécifique.
Cette même nature "d'enfants", d'"être en devenir", est censée impliquer que ces jeunes humains soit éduqués ("pour leur bien"), et pour ce faire contenus dans des familles, des foyers et des écoles, et soumis à un travail constant d'apprentissage. De fait, le "manque de discernement" qui leur est imputé a pour conséquence que la société retire aux "enfants" tout pouvoir effectif sur leur vie.
Peut-on développer une lecture politique, féministe, de ces rapports sociaux adultes/enfants si peu problématisés ? Peut-on légitimement analyser la condition des "enfants" en termes d'appropriation privée (familiale) et d'instrumentalisation sociale (éducative) ? Dans quelle mesure peut-on parler de domination adulte sur les enfants ? […] Cet atelier propose donc d'étudier un type de discrimination et de domination qui a été peu problématisé, de façon à faire émerger certaines de ses caractéristiques propres, son importance, et les liens tissés avec d'autres oppressions fondamentales tout particulièrement les oppressions de genre. »
Décider « d'avoir un enfant » implique d'accepter d'exercer un pouvoir immense sur une autre personne. En particulier, de lui donner des ordres et de se donner tous les moyens de se faire obéir (persuasion, incitation, répression). Et ce « pour son bien », pendant des années. Ce n'est tout de même pas rien.
Ici, un article sur les usages de la maternité dans l'histoire du féminisme.
* * * * * * *
Au terme de cet article-fleuve un peu boueux, avec quelques cailloux et quelques crocodiles, je voulais juste dire que la méduse essaie de revenir. Elle n'a plus toutes ses neurones rangées dans le bon ordre, il semble, mais elle fera de son mieux. A son petit rythme de mollusque (qui ne fait pas ses nuits).
N'hésitez pas à écrire tous les commentaires qui vous passent par la tête :)
 En France l'année 2011 est marquée par « l'affaire du coq » : une affiche du centre LGBT pour la marche des fiertés aux coloris rappelant fortement le bleu/blanc/rouge et arborant un coq, avec le slogan « En 2011 je marche en 2012 je vote » fait vivement polémique. Ce sont principalement les Lesbiennes of Color (groupe doublement non mixte : qui ne rassemble que des femmes lesbiennes non blanches) et les Homosexuels Musulmans de France qui prennent la parole. La présidente du centre LGBT répond à leurs critiques dans une lettre qu'elle intitule « les ayatollahs de l'intérieur » (on appréciera le choix de l'insulte), et dans laquelle elle évoque l' « ultra-communautarisme » des personnes qui dénoncent le racisme de cette affiche. Selon elle les LOC et les HMF font le lit des extrêmes et méprisent l'idéal républicain. Ainsi parler du racisme, c'est communautariste, résume Gabriell Galli.
En France l'année 2011 est marquée par « l'affaire du coq » : une affiche du centre LGBT pour la marche des fiertés aux coloris rappelant fortement le bleu/blanc/rouge et arborant un coq, avec le slogan « En 2011 je marche en 2012 je vote » fait vivement polémique. Ce sont principalement les Lesbiennes of Color (groupe doublement non mixte : qui ne rassemble que des femmes lesbiennes non blanches) et les Homosexuels Musulmans de France qui prennent la parole. La présidente du centre LGBT répond à leurs critiques dans une lettre qu'elle intitule « les ayatollahs de l'intérieur » (on appréciera le choix de l'insulte), et dans laquelle elle évoque l' « ultra-communautarisme » des personnes qui dénoncent le racisme de cette affiche. Selon elle les LOC et les HMF font le lit des extrêmes et méprisent l'idéal républicain. Ainsi parler du racisme, c'est communautariste, résume Gabriell Galli. 




 Dans l'enseignement dispensé en France dans les collèges et lycées comme dans les universités, on sépare « l'histoire de France » (c'est-à-dire de la métropole) de « l'histoire de la colonisation » (l'histoire de l'empire). Une critique fréquente des historien.ne.s des États-Unis porte sur le caractère factice de cette séparation : vous parlez de deux choses différentes, dit par exemple
Dans l'enseignement dispensé en France dans les collèges et lycées comme dans les universités, on sépare « l'histoire de France » (c'est-à-dire de la métropole) de « l'histoire de la colonisation » (l'histoire de l'empire). Une critique fréquente des historien.ne.s des États-Unis porte sur le caractère factice de cette séparation : vous parlez de deux choses différentes, dit par exemple 

 Cet article judicieusement commenté commence justement par l'évocation du bouquin de Christine Bard,
Cet article judicieusement commenté commence justement par l'évocation du bouquin de Christine Bard,  – peut-être mettre au centre de cette réflexion non plus la jeune femme qui habite en banlieue, mais une personne transsexuelle ou transgenre mtf pourrait en être un bon moyen ? (Non pas que seule une personne mtf puisse éprouver le désir légitime d'être « féminine ». Mais il me semble que venant d'une personne ftm, ce désir sera plus difficilement rembarré par mes petits élans fielleux – ces élans qui voudraient, parfois, rhabiller en survêt' et baskets toutes les grues en escarpins et jupes trop serrées que je croise dans la rue – élans mauvais, acrimonieux, venimeux. Mauvaise bête que je suis.)
– peut-être mettre au centre de cette réflexion non plus la jeune femme qui habite en banlieue, mais une personne transsexuelle ou transgenre mtf pourrait en être un bon moyen ? (Non pas que seule une personne mtf puisse éprouver le désir légitime d'être « féminine ». Mais il me semble que venant d'une personne ftm, ce désir sera plus difficilement rembarré par mes petits élans fielleux – ces élans qui voudraient, parfois, rhabiller en survêt' et baskets toutes les grues en escarpins et jupes trop serrées que je croise dans la rue – élans mauvais, acrimonieux, venimeux. Mauvaise bête que je suis.) des passages qui m'avait le plus interpelée, le plus bousculée, laissée le plus perplexe et pleine de questions que je n'aurais pas posées de ma place, auxquelles il m'était impossible de répondre, depuis ma place, parce que tout cela – ce continent, du pouvoir du sexe – est très éloigné de moi (de ma position de genre, de ma sexualité, de ma vie).
des passages qui m'avait le plus interpelée, le plus bousculée, laissée le plus perplexe et pleine de questions que je n'aurais pas posées de ma place, auxquelles il m'était impossible de répondre, depuis ma place, parce que tout cela – ce continent, du pouvoir du sexe – est très éloigné de moi (de ma position de genre, de ma sexualité, de ma vie). ]
] Dans la deuxième des six parties de son texte, elle évoque son adolescence, et ce qu'a signifié pour elle, alors, être féministe. Le début de cette partie (p.185 et suivantes) est saisissant ; j'adore ce passage. Le côté fascinant de son récit est renforcé par le contraste avec la fin de la première partie : on passe, à la faveur d'un saut de paragraphe, d'un texte sec, lourd, plein de catégories et de relations logiques compliquées, d'un bloc de concepts arides et noueux, à ça : « j'ai grandi en me nourrissant des versions commerciales et populaires du féminisme de la décennie 1970. Pendant des années je me suis vue comme une féministe, et si je ne sais plus très bien ce que ça impliquait au juste, il s'agissait, j'en suis sûre, d'être sexy. »
Dans la deuxième des six parties de son texte, elle évoque son adolescence, et ce qu'a signifié pour elle, alors, être féministe. Le début de cette partie (p.185 et suivantes) est saisissant ; j'adore ce passage. Le côté fascinant de son récit est renforcé par le contraste avec la fin de la première partie : on passe, à la faveur d'un saut de paragraphe, d'un texte sec, lourd, plein de catégories et de relations logiques compliquées, d'un bloc de concepts arides et noueux, à ça : « j'ai grandi en me nourrissant des versions commerciales et populaires du féminisme de la décennie 1970. Pendant des années je me suis vue comme une féministe, et si je ne sais plus très bien ce que ça impliquait au juste, il s'agissait, j'en suis sûre, d'être sexy. »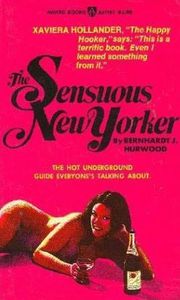
 Laura Alexandra Harris est
Laura Alexandra Harris est 



 Ce véritable modèle de pensée élaboré par la chercheuse figure, dans une tradition philosophique et psychanalytique, le soi dans son rapport au monde et à l'autre (la membrane est à la fois frontière, et lieu d'échange et de circulation). Elle devient pour H. Rouch un schème, c'est-à-dire un outil au travers duquel elle va penser d'autres objets, en particulier le corps, en rendant intelligible sa matérialité : le corps devient dans la pensée de Rouch une membrane, elle-même composée de multiples membranes.
Ce véritable modèle de pensée élaboré par la chercheuse figure, dans une tradition philosophique et psychanalytique, le soi dans son rapport au monde et à l'autre (la membrane est à la fois frontière, et lieu d'échange et de circulation). Elle devient pour H. Rouch un schème, c'est-à-dire un outil au travers duquel elle va penser d'autres objets, en particulier le corps, en rendant intelligible sa matérialité : le corps devient dans la pensée de Rouch une membrane, elle-même composée de multiples membranes.

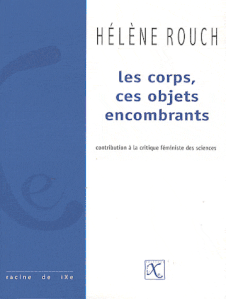 Cette «
Cette « 